Dans un récit captivant, l’écrivain, journaliste et chercheur algérien Fawzi Saâdallah nous transporte quatre siècles en arrière à travers les rues et ruelles d’Alger la joyeuse.
Il nous dévoile l’atmosphère du Ramadan à cette époque, mettant en lumière les traditions algériennes qui ont traversé les générations jusqu’à aujourd’hui, ainsi que celles qui ont disparu sans laisser de trace.
Dans une publication sur sa page Facebook, Fawzi Saâdallah, auteur de « La Casbah d’Alger, mémoire présente et souvenirs », a partagé des extraits passionnants sur l’histoire d’Alger. Il s’est notamment appuyé sur les écrits du moine espagnol Diego de Haedo, captif à Alger entre 1580 et 1585, une période où la ville connaissait une expansion militaire, économique et démographique remarquable.

Un témoignage unique sur le Ramadan à Alger au XVIe siècle
Fawzi Saâdallah écrit :
« Diego de Haedo a vécu l’effervescence du quotidien des Algérois dans ‘El Mahroussa’ (la ville protégée par Dieu), avec ses joies et ses peines. Il a observé minutieusement, tel un espion, tous les aspects de la vie locale : ses ruelles, ses marchés, son port, ses mosquées, ses boutiques, ses hammams, ses mariages, ses cortèges funéraires, ses mausolées et ses cimetières. Il n’a omis aucun détail des rituels religieux, aussi bien dans les maisons que dans les palais, et bien sûr, il a décrit les traditions du mois sacré du Ramadan. »
Dans son ouvrage Topografía e Historia General de Argel, publié pour la première fois en 1612, Diego de Haedo évoque le mois du jeûne qu’il a observé durant ses cinq années de captivité :
« Le soir, dès qu’apparaît la première étoile dans le ciel, les Algérois commencent à manger », en référence à l’heure de l’iftar, juste après le coucher du soleil.
À l’époque, « ils peuvent consommer tout type d’aliments, viandes ou poissons, à leur guise, tout au long de la nuit, jusqu’à deux heures avant l’aube, moment où l’on bat du tambour pour annoncer le dernier repas (le s’hour). Cependant, beaucoup se contentent d’un seul repas. »
Une tradition qui perdure encore aujourd’hui, à la différence des prix des denrées alimentaires, qui étaient bien plus abordables dans cette ville florissante…
La disparition de certaines traditions ramadanesques
L’usage du tambour pour annoncer le s’hour, autrefois répandu dans les villes musulmanes anciennes, a disparu prématurément en Algérie, comme de nombreuses autres coutumes locales, après la colonisation française en 1830.
Diego de Haedo décrit cette pratique en ces termes :
« Aux environs de minuit, certains habitants sortent dans la ville et battent du tambour pour réveiller les gens et leur rappeler de prendre leur dernier repas avant l’aube. Deux heures avant le lever du jour, ils recommencent, afin que personne ne manque l’heure du s’hour. Les plus pieux font ensuite leurs ablutions et se rendent à la mosquée pour prier. »
Il conclut en soulignant que « l’observance du jeûne est largement répandue parmi les habitants d’El Mahroussa ».
Entre prières et festivités nocturnes
Entre l’iftar et l’imsaq (l’heure de l’abstinence alimentaire), les Algérois d’hier et d’aujourd’hui n’ont pas tant changé. Depuis des siècles, les nuits du Ramadan sont rythmées par la prière dans les mosquées, les rencontres dans les cafés, les promenades en ville et les visites aux proches, souvent accompagnées de présents et de spécialités culinaires du mois sacré.
Cependant, une tradition disparue, qui existait à l’époque ottomane et que Diego de Haedo a lui-même observée, mérite d’être mentionnée :
« À la mi-Ramadan, notamment parmi les Turcs et les renégats (chrétiens convertis à l’islam), des groupes de trente à quarante personnes confectionnent une structure en bois recouverte d’un haïk (un grand voile traditionnel), lui donnant l’apparence d’un chameau. Ils parcourent alors les ruelles d’Alger en jouant de la zorna (flûte traditionnelle), en tambourinant et en dansant. Lorsqu’ils arrivent devant les maisons des notables et des riches, ils s’arrêtent et jouent de la musique jusqu’à ce qu’on leur ouvre la porte pour leur offrir des pièces d’argent. Ces pièces sont ensuite partagées équitablement entre tous les membres du groupe, créant ainsi une ambiance festive dans ‘la Joyeuse’ (surnom d’Alger). »
Une tradition qui témoigne du mélange unique entre piété et célébration dans l’Alger d’autrefois…
Qui est Fawzi Saâdallah ?
Fawzi Saâdallah est un écrivain, journaliste et chercheur algérien, natif d’Alger. Il s’est fait connaître par ses reportages approfondis sur la capitale, explorant ses aspects architecturaux, historiques et culturels. Ses lecteurs l’ont surnommé « le conteur de la Casbah ».
Depuis les années 1990, il s’est spécialisé dans l’histoire des Juifs d’Algérie, publiant trois ouvrages de référence :
- Juifs d’Algérie… Ces inconnus
- Juifs d’Algérie… L’heure du départ
- Juifs d’Algérie… Chants et musiques de leur époque
Son travail constitue une véritable encyclopédie sur les Juifs d’Algérie. Il s’intéresse également au patrimoine musical algérien, notamment religieux.









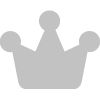
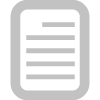

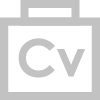
Ramadan 2025 : Quelles sont les prévisions astronomiques pour le début du mois sacré ?