BEJAIA – Elle s’appelle Zina Mebarki de son nom de guerre « N’djima ». A 15 ans non révolus, elle s’était engagée dans les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN), à un moment ou même ses frères au combat y accédaient difficilement. C’était, en 1955.
Son secret, outre sa flamme, réside dans sa foi et sa détermination à combattre l’ennemi. Elle s’est retrouvée propulsée, avec deux de ses meilleures amies (Malika et Ldjida), au cœur de l’actualité, qui tirait à grande manchette sur leur intégration précoce au sein du Front, a-t-elle confié à l’APS, qui l’a rencontré à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes (8 mars).
Toutes trois, et elle spécialement, n’avaient pas encore été admises au maquis. Mais c’était suffisant pour attirer l’attention sur elles, notamment celle du Colonel Amirouche, qui connaissait sa famille, antérieurement, au détour de ses virées et des repas partagés avec ses parents à Tala Hamza, plus précisément au village d’Ath-M’Barek, à 7 km au sud-est de Bejaia.
N’ayant encore ombre de soupçon sur l’engagement patriotique de sa famille, le chef de la wilaya III historique a décidé de son incorporation au sein de l’ALN, confie-t-elle.
Malgré son jeune âge, mentalement, elle était prête. « Je n’avais qu’un rêve : celui de prendre les armes contre ces occupants + indus et impies+ » et qui, de surcroit, avaient spolié sa famille de leurs terres, à Ibourassene (Oued Ghir), le village faisant face à celui qui leur à servi d’exil.
« Lorsque j’entendais les moudjahidine célébrant à tue-tête le succès de leurs opérations nocturnes contre les troupes coloniales, ou leurs infrastructures, je m’en réjouissais et m’en délectais d’autant que parmi eux, il y avait mon frère aîné et mes cousins qui, du reste, n’avaient pas tardé à rejoindre le maquis et y devenir des chefs », rapporte-t-elle encore. Elle explique : « Tout de suite, j’a décidé, en catimini, du moins en mettant dans l’ignorance mes parents, de rejoindre le maquis, précisément là ou stationnait mon frère à Ighil Ouyazit, dans les montagnes à une quarantaine de kilomètres de Bejaia ».
« Avec Ldjida, j’ai acheté les tickets en cassant ma tirelire et l’argent que je piquais à mon père et je m’y étais rendu (à Ighil Ouyazit) en prenant le bus d’Azrou N’Bechar. Une fois sur place, les gens m’ont adopté en raison de la notoriété de mon frère sans pour autant qu’il leur soit révélé le motif de ma venue », se souvient-elle.
Et de poursuivre : « alerté en urgence, mon frère, si Tahar, n’avait pas tardé à rappliquer. Et quand il a appris le secret, il s’est mis en colère, décidant tout de go de me renvoyer à mes pénates. « Ta place n’est pas au front, mais à Bejaia, où tu vas devoir et pouvoir procurer des médicaments, collecter les contributions des citoyens et rapporter du renseignement, ça sera plus facile et plus commode », lui dira-t-il, avant de procéder à son renvoi.
A Bejaia, ce n’était plus possible d’activer. L’armée coloniale était à ses trousses et sa maison familiale au village a été brûlée et les champs retournés au blindé. Ses parents se sont réfugiés dans le quartier de « Houma Oubazine » et faisaient l’objet d’intenses recherches, rendant périlleux son maintien sur place.
Son père, qui était furieux initialement contre son projet de rejoindre les montagnes, a dû se raviser. « Vas ma fille. Tu as ma bénédiction. Si j’avais ton âge, j’en aurais fait pareil », lui a-t-il dit, en l’encourageant à s’y rendre sans trop tarder. Et c’est ce qu’elle a fait. Après une formation et une instruction militaire de quelques mois, notamment dans le tir et le maniement des armes, elle est rentrée de plain pied dans la guerre, crapahutant dans les collines de la zone 2 et participant à nombre d’offensives et d’accrochages entre Bejaia et Sétif.
Elle avait ainsi partagé les rigueurs du temps, du relief et de la vie sous les obus et les balles, de sesfrères d’armes, cantonnés en forêts, et manquant fréquemment de nourriture, d’eau et d’hygiène. « Une fois, en pleine opération Jumelles (en 1959) alors que nous étions cernés et soumis à un bombardement massif, nous avions survécu en se partageant un kilo de sucre, un mois durant. Tous les points d’eau et les vergers étaient sous haute surveillance, nous étions dans l’impossibilité de tenter le moindre mouvement », se rappelle-t-elle encore une fois, estimant que c’est grâce à Dieu qu’elle s’en est sortie.
Elle évoque, dans un flux de paroles furieux, tous les sacrifices consentis et plongeant tristement dans le souvenir de tous « les frères » qui y ont laissé leurs vies, dont des jeunes à la fleur de l’âge. « C’était notre destin : vaincre ou mourir », a-t-elle conclu, soulignant que « si cela devait être, je le referais sans hésitation. Aujourd’hui, si on me demandait de me jeter au feu pour le salut de l’Algérie, je me jetterai au feu », dit-elle avec une sincérité déconcertante.
Agée de 81 ans (elle est née le 13 juin 1942), Na N’djima, qui n’a jamais été à l’école, du temps du colonialisme, a rattrapé son temps, ayant appris à l’indépendance à lire et à écrire, et à occuper des postes importants dans sa vie active, notamment élue pendant huit ans à l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Bejaia et syndicaliste de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), durant 14 ans au sein d’une importante entreprise nationale de textile. Toute sa vie aura été un modèle d’engagement, de passion et de courage, celui d’une femme au parcours atypique.





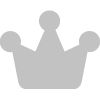



Akli Mellouli : un sénateur français d’origine algérienne au parcours atypique