
ALGER- Les massacres du 8 mai 1945 s’inscrivent dans une longue série de crimes de guerre et contre l’humanité perpétrés par la France coloniale depuis que ses armées ont foulé la terre d’Algérie en 1830, ces crimes revêtant à chaque fois une dimension génocidaire, de par leur ampleur, leur caractère indiscriminé et leur durée dans le temps, affirment des historiens et des témoins.
En effet, l’histoire de la colonisation de l’Algérie est jalonnée de tueries massives d’Algériens, notamment au début de la conquête, commises, entre-autres, par le maréchal Bugeaud, le général Cavaignac ou le colonel Pélissier, et dont le récit est fait par des chroniqueurs français, en l’occurrence des officiers de l’armée, eux-mêmes horrifiés par les procédés utilisés, notamment les « enfumades », consistant à asphyxier des personnes réfugiées ou enfermées dans une grotte. Des milliers d’Algériens, hommes, femmes et enfants, périrent de la sorte.
Concernant les massacres du 8 mai 1945, plusieurs témoignages restituent les faits de cette tragédie qui, paradoxalement, coïncida, avec la célébration de la victoire des Alliés sur les nazis. Elle marquera les esprits des Algériens si profondément qu’ils prendront la résolution d’entreprendre une lutte armée pour arracher leur liberté et leur dignité
Tout commença ce « mardi noir » du 8 mai 1945 lorsque le préfet de police d’alors, Olivieri, tenta d’arracher le drapeau national des mains de Saâl Bouzid qui était en tête d’une marche des Algériens à Sétif, avant de l’abattre à bout portant avec son pistolet. Agé d’à peine 22 ans, il était la première victime des massacres qui allaient suivre.Le but de cette marche était de réclamer pacifiquement à la France d’honorer sa promesse de reconnaître l’indépendance de l’Algérie.
Les Algériens, dont 60.000 combattirent sur le front en Europe contre l’Allemagne nazie, parmi lesquels 12.000 perdirent la vie, espéraient que la fin du deuxième conflit mondial allait signifier pour eux le recouvrement de leurs droits à l’indépendance de leur pays, écrit l’universitaire Abdelkader Benarab, auteur de l’ouvrage « La bataille de Sétif ».
Le meurtre de Saâl Bouzid fut le point de départ d’une répression sanglante pendant plus de deux mois durant lesquels l’armée française multiplia les exécutions sommaires, individuelles et collectives, à travers les villages et campagnes pour briser la revendication d’indépendance.
Plusieurs charniers attestent de l’ampleur des massacres
Dans son livre « Sétif, la fosse commune », le journaliste Kamel Beniaiche relate les témoignages de survivants, recueillis durant plus de 12 ans dans des villages de la région, pour montrer que les massacres du 8 mai 1945 ne se sont pas limités aux villes de Sétif, Guelma et Kherrata.
El Ouricia (10 km de Sétif), militaires et colons français, constitués en milices, arrêtèrent et tuèrent des dizaines d’Algériens, dont plusieurs militants du Parti du peuple algérien ( PPA), comme en témoigne Ahmed Boudiaf, devenu militant du Front de libération nationale.
Au village d’Aïn Abbassa, sur lequel s’abattu une violence extrême, « 84 exécutions sommaires ont anéanti un groupe de militants ayant pour habitude de se rencontrer au café +Nadi Abbas+ (Cercle des fidèles de Ferhat Abbas) », selon des témoins.
Une des localités où les exactions furent des plus brutales, Bouandas (70 km au nord de Sétif), pas moins de « 96 exécutions ont été enregistrées en une seule journée », et sur la route de Bejaia, « les pires méthodes de torture ont été employées », se souviennent des témoins.
L’auteur rapporte également sur la foi de témoignages plusieurs affrontements entre Algériens et colons, suivis d’une violente répression militaire qui fît plusieurs milliers de morts à El Eulma, Kherrata, ou encore Aïn El Kbira parmi les Algériens. Cette répression se traduisit aussi par « plus de 300 sorties de l’aviation militaire coloniale en six jours, qui rasa de nombreux villages, obligeant les survivants à fuir dans les montagnes.
« C’était l’horreur absolue », se remémore Said Allik, 87 ans, témoin malgré lui, de la mort, à Kherrata, de cinq membres de sa famille: son père, sa mère, ses deux frères et sa sœur (Yamina), âgée à peine de quatre mois, tous exécutés à bout portant. A l’époque des faits il avait 12 ans. Il a eu la vie sauve parce qu’il s’était caché derrière un rocher.
« Les morts étaient bons pour la fosse commune et un bon nombre de corps disparurent dans un four à chaux de Héliopolis, près de Guelma. De multiples témoignages en attestent et des charniers entiers ont été découverts par la suite », relate l’universitaire Abdelkader Benarab.
En 2010, l’hebdomadaire français Le Point publia de larges extraits du rapport du consul général de Grande-Bretagne, alors en poste à Alger, John Eric Maclean Carvell, sur « l’impitoyable » riposte des troupes françaises aux manifestations des Algériens.
« Je suis certain qu’autant de sang n’aurait pas coulé si les militaires français n’avaient pas été aussi impatients de perpétrer un massacre », écrivit le diplomate britannique, relevant que l’aviation fut mise à contribution et les navires de guerre stationnés sur les côtes de Bejaia et
Jijel pilonnèrent villages et douars « sans distinction », les détruisant entièrement.
La France doit reconnaitre ces crimes de guerre en Algérie, « il y va de son honneur »
Pour Hassen Remaoun, historien et chercheur au Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran, »l’intention de génocide » dans les massacres du 8 mai 1945 « n’est pas exclue », au regard des exactions perpétrés, et la France doit reconnaitre les crimes de guerre commis en Algérie pendant la colonisation, car « il y va de son honneur ».
Dans une contribution publiée en mai 2020 sur son blog, l’universitaire et spécialiste de la question coloniale Olivier Le Cour Grandmaison a regretté « le silence de la France » sur les massacres du 8 mai 1945, soulignant que les « descendants de ces victimes attendent toujours la reconnaissance de ces crimes » par la France.
En 2019, l’anticolonialiste Henri Pouillot adressa, en tant que témoin de la guerre d’Algérie, une lettre au chef de l’Etat français insistant sur le besoin impérieux pour leur génération d’anciens combattants que les crimes contre l’humanité (tortures, viols…), les crimes de guerre (600 à 800 villages rasés au napalm et utilisation du gaz VX et Sarin…) et les crimes d’Etat (massacres de Sétif, Guelma et Kherrata en mai 1945 et massacres du 17 octobre 1961 à Paris) soient reconnus comme tels et condamnés ».
Le collectif unitaire français pour la reconnaissance des crimes d’Etat de 1945 en Algérie demanda en 2016 à l’ancien président François Hollande de « dire la vérité sur les massacres du 8 mai 1945 ».
« Si le 19 mars, le président de la République a reconnu que le système colonial en Algérie était +injuste+ et +niait les aspirations des peuples à décider d’eux-mêmes+, il faut qu’il aille plus loin en disant la vérité sur les massacres du 8 mai 1945 », affirma le collectif, estimant « impossible » de célébrer l’anniversaire de la victoire contre le fascisme « sans vouloir arracher à l’oubli ce qui s’est passé en Algérie ce même 8 mai et les jours suivants ».
« Amputer notre histoire commune par l’occultation de ce crime d’Etat ne permet pas à la France d’en finir avec la page coloniale de son histoire », estima ce collectif regroupant plusieurs partis politiques et syndicats ainsi que des dizaines d’associations.



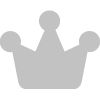
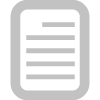

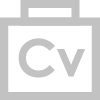
L’Université d’Alger commémore la Journée nationale de la mémoire et le 79ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945